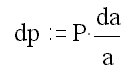 (1), où P est une constante.
(1), où P est une constante.Le chapitre Présentation de l'ouvrage "Temps de la nature, nature du temps" (CNRS Editions, 2018) commence par les lignes suivantes.
"Dans l'histoire de la philosophie, la question du temps a été abordée selon [...] deux tendances opposées. Le temps a été pensé d'un côté comme temps de la nature, par exemple quand Aristote fait du temps le nombre ou la mesure du mouvement, et de l'autre comme une structure essentielle de la conscience [...]. Paul Ricoeur (1985) a soutenu que ces deux notions; le « temps du monde » et le « temps de l'âme », le temps de la nature et le temps de l'expérience vécue, sont irréductibles l'une à l'autre et constituent une aporie insurmontable de la philosophie."
Foin de contradiction, point d'irréductibilité... Il est montré ici qu'il existe simplement une relation logarithmique entre les deux notions ;-]. Il est ainsi facile de passer de l'âge objectif à l'âge subjectif.
C'est un fait d'expérience courante : le temps paraît passer plus vite à 40 ans qu'à 20 ans. Ceci s'interprète assez naturellement: à l'âge de 1 an, la durée de 1 an représente toute la vie de l'individu; à 20 ans, elle n'en est plus qu'un vingtième; à 40 ans, un quarantième... La durée perçue subjectivement correspondrait ainsi à un temps relatif plutôt qu'absolu.
Dans cette hypothèse, si da est une durée objective écoulée, c'est-à-dire une variation de l'âge a mesurée au chronomètre, alors la durée correspondante dp perçue subjectivement doit être proportionnelle à da/a. Cette quantité étant un rapport sans dimension, le coefficient de proportionnalité P possède nécessairement la dimension d'un temps. On doit donc écrire :
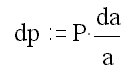 (1), où P est une constante.
(1), où P est une constante.On voit que, lorsque a = P, il vient dp = da donc P s'interprète comme l'âge auquel la perception subjective de la durée s'identifie à la durée objective. C'est donc une valeur à déterminer en fonction de l'expérience vécue.
L'équation différentielle (1) s'intègre en:
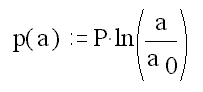 (2).
(2).On voit que cette constante d'intégration caractérise l'unité avec laquelle l'âge est mesuré. On peut donc la choisir librement. Par commodité, on prend a0 = 1 an, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire apparaître cette constante si l'on convient que a est le nombre qui exprime l'âge en années. L'équation (2) se simplifie alors en :
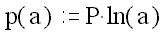 (3).
(3).Il reste à choisir P empiriquement. Pour une raison qui va être expliquée plus bas, il est ici proposé de donner à P la valeur suivante :
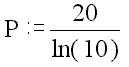 (4), soit P=8,686 ans.
(4), soit P=8,686 ans. Ce choix permet de transformer l'expression (3) en utilisant le logarithme décimal log:
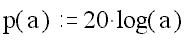 (5).
(5).Cette égalité exprime que l'âge perçu s'exprime en décibels en fonction de l'âge objectif.
La variation en est illustrée par la courbe suivante.
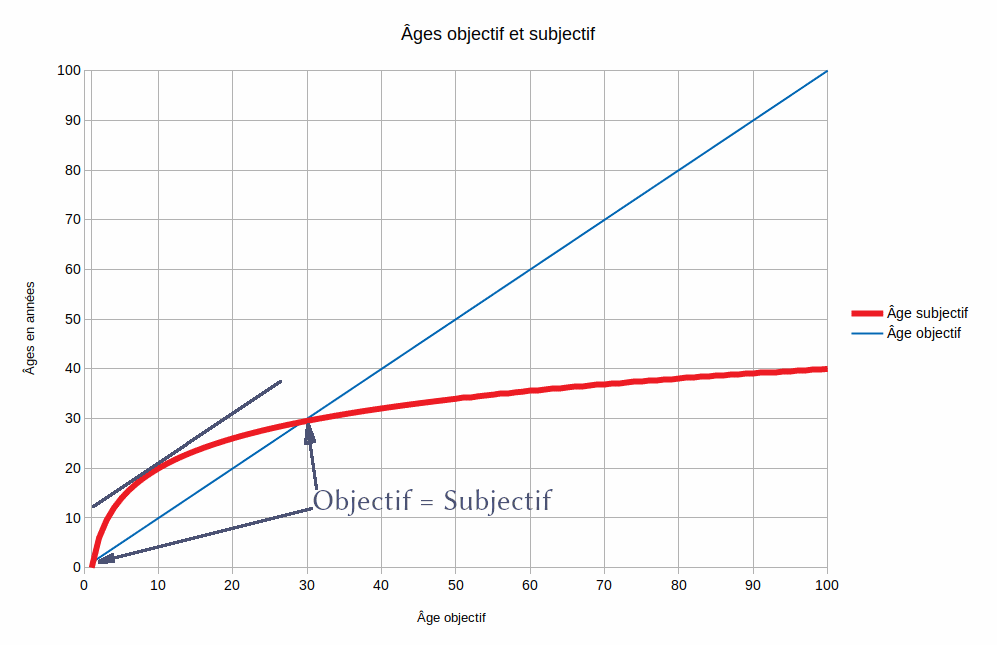 .
.On vérifie que les durées objective et subjective, c'est-à-dire les rythmes d'écoulement du temps réel et perçu, sont identiques à l'âge P choisi (pente de la courbe à 8,7 ans).
Surtout, cette valeur de P permet de rendre compte d'une expérience vécue. En effet, l'âge perçu et l'âge objectif sont identiques en deux points: un peu après 1 an (1,14 an) et un peu avant 30 ans (29,35 ans). Entre ces deux âges, comme le montre la courbe, l'individu se sent plus mûr qu'il ne l'est en réalité, tandis que le contraire se produit au-delà du deuxième âge. Il est vrai que l'homme mûr se sent bien plus jeune que ne l'indique son âge réel. En particulier, à en croire la courbe, à 60 ans, on a l'impression d'avoir à peine plus de 35 ans.
Cette théorie indique aussi que le tout jeune enfant, à moins d'un an, se sent plus jeune qu'il ne l'est en réalité. L'auteur avoue ne pas avoir de souvenirs suffisamment précis de son jeune âge pour évaluer la validité de ce fait...
Si vous avez plus d'un an, vous pouvez calculer vos âges objectif et subjectif avec le formulaire
suivant.
Entrer votre date de naissance : puis
.